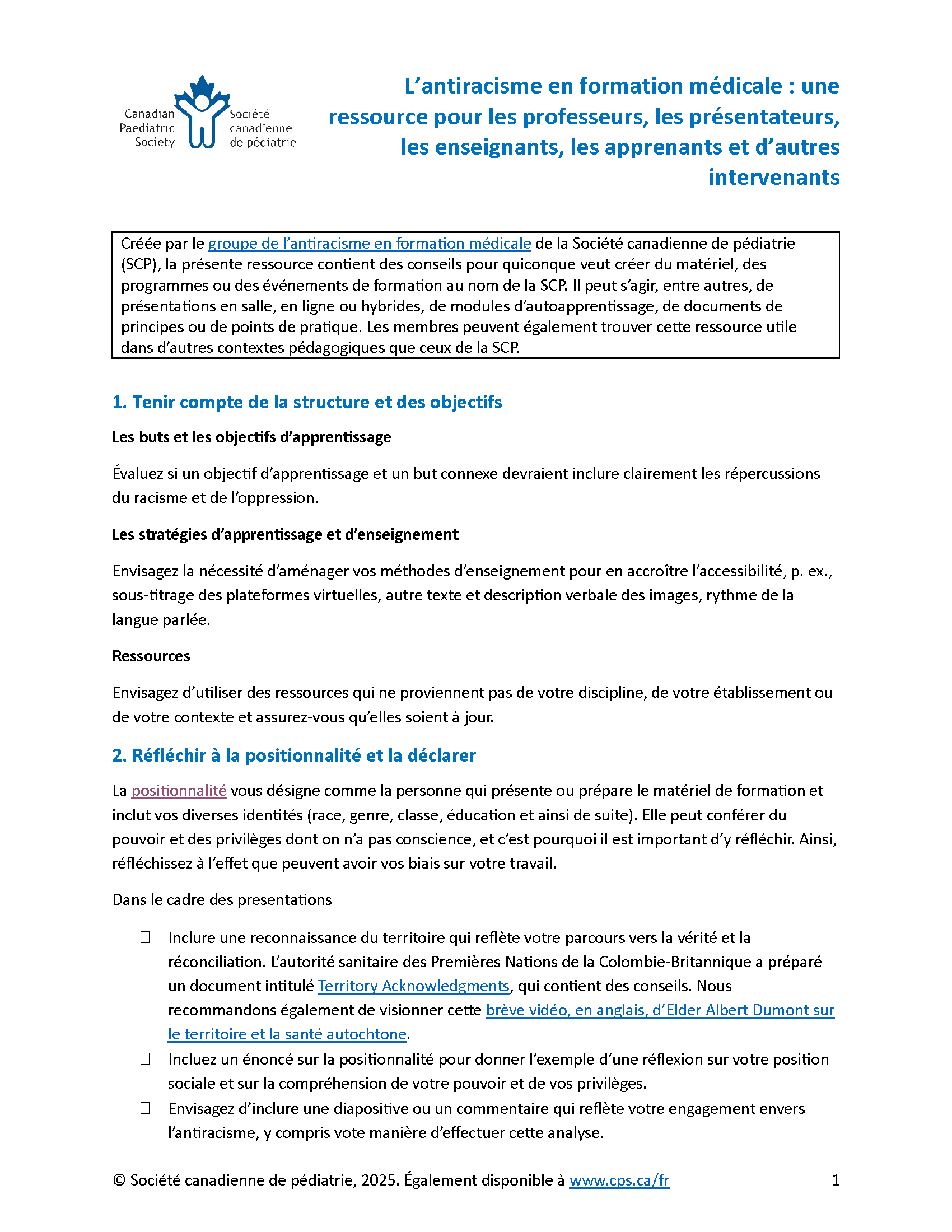L’antiracisme en formation médicale : une ressource pour les professeurs, les présentateurs, les enseignants, les apprenants et d’autres intervenants
Créée par le groupe de l’antiracisme en formation médicale de la Société canadienne de pédiatrie (SCP), la présente ressource contient des conseils pour quiconque veut créer du matériel, des programmes ou des événements de formation au nom de la SCP. Il peut s’agir, entre autres, de présentations en salle, en ligne ou hybrides, de modules d’autoapprentissage, de documents de principes ou de points de pratique. Les membres peuvent également trouver cette ressource utile dans d’autres contextes pédagogiques que ceux de la SCP.
Pour en tirer une meilleure expérience et maximiser l’efficacité de cette ressource, nous recommandons la lecture préalable de Le racisme en formation médicale : ce que c’est, pourquoi c’est important et ce qu’on peut faire.
Cet outil est également offert sous forme de fichier pdf que vous pouvez télécharger et imprimer.
1. Tenir compte de la structure et des objectifs
Les buts et les objectifs d’apprentissage
Évaluez si un objectif d’apprentissage et un but connexe devraient inclure clairement les répercussions du racisme et de l’oppression.
Les stratégies d’apprentissage et d’enseignement
Envisagez la nécessité d’aménager vos méthodes d’enseignement pour en accroître l’accessibilité, p. ex., sous-titrage des plateformes virtuelles, autre texte et description verbale des images, rythme de la langue parlée.
Ressources
Envisagez d’utiliser des ressources qui ne proviennent pas de votre discipline, de votre établissement ou de votre contexte et assurez-vous qu’elles soient à jour.
2. Réfléchir à la positionnalité et la déclarer
La positionnalité vous désigne comme la personne qui présente ou prépare le matériel de formation et inclut vos diverses identités (race, genre, classe, éducation et ainsi de suite). Elle peut conférer du pouvoir et des privilèges dont on n’a pas conscience, et c’est pourquoi il est important d’y réfléchir. Ainsi, réfléchissez à l’effet que peuvent avoir vos biais sur votre travail.
Dans le cadre des présentations
- Inclure une reconnaissance du territoire qui reflète votre parcours vers la vérité et la réconciliation. L’autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique a préparé un document intitulé Territory Acknowledgments, qui contient des conseils. Nous recommandons également de visionner cette brève vidéo, en anglais, d’Elder Albert Dumont sur le territoire et la santé autochtone.
- Incluez un énoncé sur la positionnalité pour donner l’exemple d’une réflexion sur votre position sociale et sur la compréhension de votre pouvoir et de vos privilèges.
- Envisagez d’inclure une diapositive ou un commentaire qui reflète votre engagement envers l’antiracisme, y compris vote manière d’effectuer cette analyse.
- Envisagez d’inclure une note expliquant que la langue peut devenir désuète ou offensante et que vous êtes ouvert aux commentaires, en vue d’un apprentissage continu.
3. Passer le matériel en revue
Le langage et la terminologie
☐ Le langage est-il utilisé de manière respectueuse dans le contexte local et canadien?
- Mettez des majuscules aux ethnies et aux races (p. ex., Noir, Asiatique).
- Utilisez « peuples autochtones » plutôt que « Autochtones » et convenez que les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont des peuples distincts aux expériences uniques.
- Évitez de faire des hypothèses sur le genre d’une personne.
☐ Le vocabulaire est-il axé sur la personne plutôt que sur l’affection (p. ex., « personne ayant l’autisme » plutôt que « autiste »)?
Les images
☐ Avez-vous obtenu l’autorisation d’utiliser des images?
☐ Les images ont-elles un objectif particulier dans votre contenu?
☐ Les images sont-elles représentatives de la population desservie?
☐ Sans que vous l’ayez fait exprès, les images pourraient-elles être utilisées pour renforcer les stéréotypes ou les biais?
☐ Évitez-vous les situations négatives ou tragiques dans l’imagerie visuelle?
☐ Choosing images for sharing evidence, produit par la Collaboration Cochrane, est un bon outil pour s’orienter.
Les scénarios cliniques
☐ Les histoires des patients sont-elles anonymes et avez-vous obtenu leur consentement pour les utiliser?
☐ Les discussions de cas sont-elles représentatives des populations desservies?
☐ Les scénarios tiennent-ils compte des disparités en santé causées par les déterminants de la santé structurels et sociaux? Les déterminants structurels de la santé désignent des systèmes comme le racisme, le colonialisme, le classisme et le capacitisme.
☐ La détermination de la race, de la religion, de l’ethnie ou de la culture a-t-elle une incidence sur le scénario et démontre-t-elle des aspects importants du contenu ou des données?
☐ La langue utilisée dans les scénarios est-elle dénuée de jugement ou de condescendance?
☐ Les expériences des patients sont-elles présentées de manière respectueuse, sans moquerie ni honte?
La représentation
☐ Quels sont les facteurs culturels dans le contenu de la présentation ou de l’activité? Si votre présentation traite d’aspects culturels précis d’un ou de plusieurs groupes, réfléchissez à la personne la mieux placée pour partager ces points de vue : vous voudrez peut-être demander à des conférenciers qui ont des points de vue différents ou des expériences vécues de participer à la séance.
☐ Le contenu présente-t-il des personnes de diverses origines raciales et ethniques, sans perpétuer les stéréotypes?
☐ Des personnes de divers types corporels, de diverses aptitudes, etc., sont-elles dépeintes?
☐ Les genres sont-ils tous représentés et évite-t-on de les confondre avec le sexe biologique et l’orientation sexuelle?
☐ De l’information démographique pertinente, y compris le statut d’immigration, la nationalité, le statut de réfugié, la pauvreté, la situation socioéconomique, l’âge, la religion, la tradition religieuse ou la foi, la population de prisonniers, etc., et les effets cumulés des identités croisées?
☐ Le capacitisme est-il abordé, y compris envisager des aménagements et déterminer comment les patients ayant un handicap peuvent être touchés de façon différente?
Les biais, les stéréotypes et l’ostracisme
☐ Y a-t-il du contenu qui favorise la honte, les stéréotypes ou l’ostracisme? Par exemple, toujours parler des Noirs lorsqu’il est question d’obésité, de personnes autochtones lorsqu’on parle de diabète, de Latinos quand il s’agit d’immigrants sans papiers, etc.
☐ Les biais et l’ostracisme demeurent dans le haut de la liste des problèmes de santé mentale. La santé mentale, y compris son intersection avec la santé physique et l’ostracisme qui s’y associe, devrait être abordée de manière proactive.
☐ Le poids et l’indice de masse corporelle sont-ils abordés sans promouvoir les stéréotypes ou l’ostracisme? Des facteurs génétiques, sociaux et structurels contribuent-ils au poids du patient?
☐ Les convictions religieuses sont-elles présentées sans présumer d’homogénéité et sans favoriser l’ostracisme?
Pour approfondir vos lectures
- Société canadienne de pédiatrie. Des ressources pour la lutte contre le racisme à l’intention des dispensateurs de soins aux enfants et aux adolescents
- Institut canadien d’information sur la santé (2022). Directives sur l’utilisation des normes de collecte de données fondées sur la race et l’identité autochtone pour la production de rapports sur la santé au Canada
- JAMC (2023). CMAJ’s new guidance on the reporting of race and ethnicity in research articles
- Collaboration Cochrane (2020). Choosing images for sharing evidence: a guide.
- Université de la Colombie-Britannique. EDI Glossary
- Université de Toronto (février 2022). Black at Temerty Medicine: Addressing Anti-Black Racism at Temerty Medicine Accountability Report
Articles de revues scientifiques
- Adopting an antiracist medical curriculum. The BMJ Opinion. Le 19 février 2021.
- Caruso Brown AE, Hobart TR, Botash AS, Germain LJ. Can a checklist ameliorate implicit bias in medical education? Med Educ Mai 2019;53(5):510.
- Jindal M, Heard-Garris N, Empey A, Perrin EC, Zuckerman KE, Johnson TJ. Getting “our house” in order: re-building academic pediatrics by dismantling the anti-black racist foundation. Acad Pediatr Novembre-décembre 2020;20(8):1044-50.
- Marcelin JR, Siraj DS, Victor R, Kotadia S, Maldonado YA. The impact of unconscious bias in healthcare: How to recognize and mitigate it. J Infect Dis. Le 20 août 2019;220(220 Suppl 2):S62-73.
- Nieblas-Bedolla E, Christophers B, Nkinsi NT, Schumann PD, Stein E. Changing how race is portrayed in medical education: Recommendations from medical students. Acad Med Décembre 2020;95(12):1802-6.
- Nivet MA. Minorities in academic medicine: review of the literature. J Vasc Surg. Avril 2010;51(4 Suppl):53S-8S.
Amélioration continue et adaptation
Nous vous remercions de votre engagement à contrer le racisme et l’oppression. La langue est en constante évolution, et il se peut que la terminologie utilisée dans ces ressources devienne désuète ou offensante. Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires en vue d’une amélioration continue, à info@cps.ca.
Mise à jour : le 28 février 2025